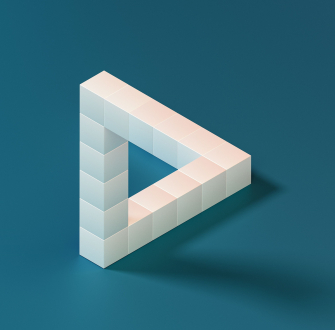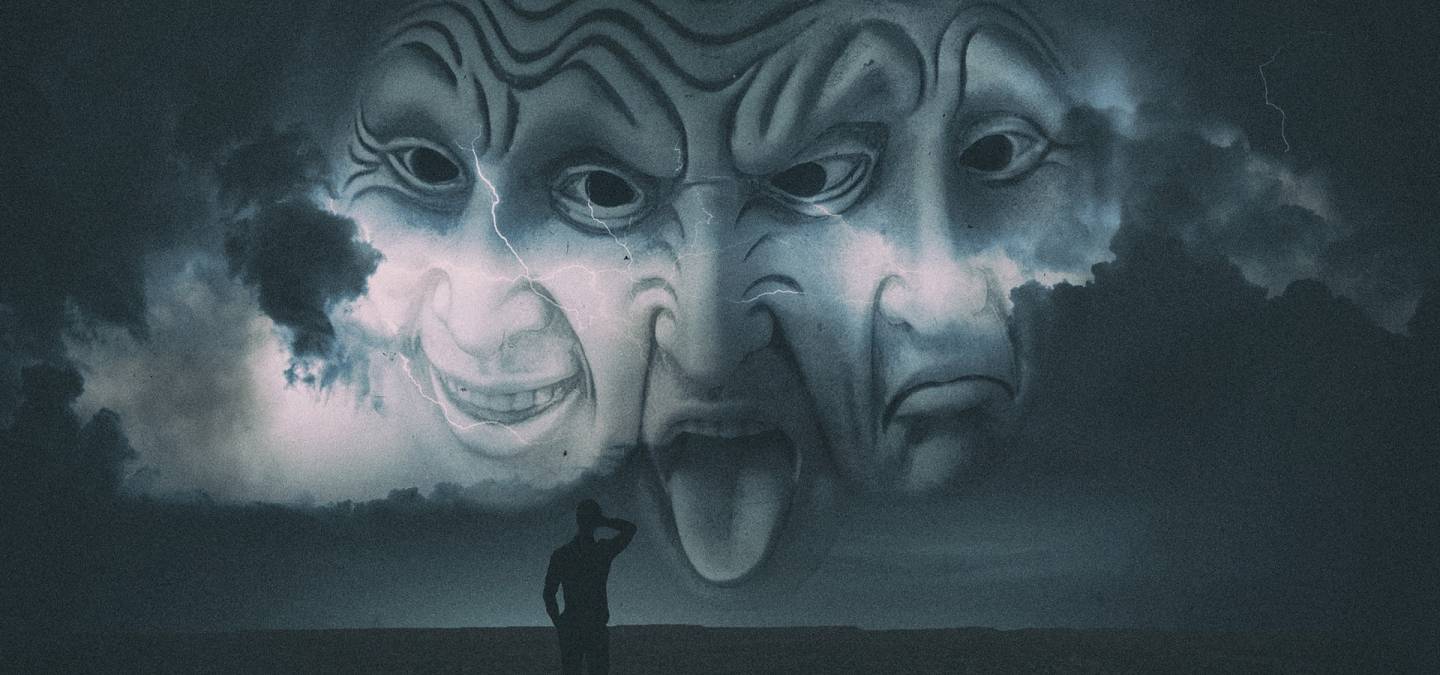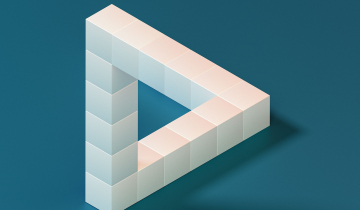Dans cette série de trois articles, seront passés en revue quelques fameux paradoxes logiques en donnant une idée de leur solution et du fait qu'un paradoxe, « guéri » par une formalisation convenable, devient une preuve par l'absurde en bonne et due forme.
Le Menteur : énoncés
Le paradoxe du Menteur (Euboulide, siècle $-4$)1 consiste à dire « je mens » ou, sous une forme plus précise : « la présente phrase est fausse ». Si cette phrase est vraie, alors elle est fausse (puisque c'est ce qu'elle dit) ; et si elle est fausse, comme c'est précisément ce qu'elle dit, elle est vraie ! On ne peut pas lui attribuer une valeur de vérité (« vraie » ou « fausse ») de façon cohérente.
C'est là un paradoxe (l'argument est apparemment valable et pourtant sa conclusion heurte le sens commun), mais ce n'est pas encore une contradiction. En effet, que montre-t-il ? On dit qu'une phrase est une proposition (au sens des logiciens) si elle possède une valeur de vérité : on vient donc de montrer, par l'absurde, que « la présente phrase est fausse » n'est pas une proposition. On pourrait penser que ce n'est pas bien grave : après tout, dira-t-on, beaucoup de phrases ne sont pas des propositions au sens des logiciens (par exemple les phrases impératives comme « Essayons ! » ou interrogatives comme « Comment ? » ne sont ni vraies ni fausses). Mais une légère reformulation montre qu'il y a ici un réel problème. Considérons la phrase : « la présente phrase est fausse ou dénuée de valeur de vérité ». Elle ne peut pas être vraie (puisqu'alors elle ne serait ni fausse ni dénuée de valeur de vérité, contrairement à ce qu'elle dit) ; et elle ne peut pas être fausse ou dénuée de valeur de vérité (car alors elle serait vraie puisque c'est ce qu'elle dit). Cette phrase n'est donc ni vraie, ni fausse, ni dénuée de valeur de vérité.
On pourrait chercher une issue en supposant l'existence d'autres valeurs de vérité que le vrai et le faux : la phrase aurait l'une de ces valeurs de vérité. Mais cela n'éliminerait pas le problème. En effet, considérons cette variante (qui englobe les précédentes) :
\begin{equation}\tag{$*$} \textit{La présente phrase n'est pas vraie.} \end{equation}
Si elle est vraie, alors elle n'est pas vraie (puisque c'est ce qu'elle dit) ; et si elle n'est pas vraie, comme c'est précisément ce qu'elle dit, elle est vraie ! Il faut pourtant bien qu'elle soit vraie ou qu'elle ne le soit pas ; or chacune de ces options implique l'autre, donc elle est vraie et elle ne l'est pas : voilà une belle contradiction ! (Dans la suite, quand je parlerai de paradoxes, il s'agira en fait de vraies contradictions.)
On pourrait encore tenter une échappatoire et dire : « la présente phrase » ? Mais quelle phrase ? Elle renvoie à elle-même, qui renvoie à elle-même et ainsi de suite : cette régression à l'infini ne renvoie finalement à rien, cette phrase tourne à vide, elle est dénuée de sens. Nous reviendrons sur cette question de l'autoréférence mais on peut déjà voir que cette objection ne résout pas le problème. Dans la phrase $(*)$ ci-dessus, la locution « la présente phrase » renvoie clairement à la phrase $(*)$, qui existe bien : elle est écrite, on l'a sous les yeux, elle est grammaticalement correcte et intelligible. Le fait est peut-être encore plus flagrant avec la version de Łukasiewicz, rapportée par Tarski : à la page 276, ligne 29 d'un livre2 (un recueil d'articles) on lit
$$\textrm{La proposition imprimée dans cet article à la page 276, ligne 29, n'est pas vraie.}$$
Le livre existe réellement, la phrase qui s'y trouve imprimée à la page 276, ligne 29, parle d'elle-même, telle qu'elle existe matériellement : on ne peut pas plaider qu'elle ne renvoie à rien. Et la contradiction est toujours là.
Les contradictions sont-elles contagieuses ?
L'existence d'une contradiction ne peut être prise à la légère. On pourrait même craindre qu'elle contamine tout le langage. En effet, selon les règles de la logique classique, d'une contradiction on peut déduire n'importe quelle proposition et donc aussi sa négation : il y aurait ainsi des contradictions partout ! Mais sur quoi repose ce principe de contamination ? Supposons qu'une proposition $A$ soit vraie ainsi que sa négation $\mathrm{NON\, } A$. Soit $B$ une proposition quelconque. De $A$ on déduit $A\mathrm{\, OU\, } B$ (introduction de la disjonction3) ; mais de $\mathrm{NON\, } A$ et $A\mathrm{\, OU\, } B$ on déduit $B$ (syllogisme disjonctif). C'est tout ! La signification intuitive du syllogisme disjonctif est que si on a $A$ ou $B$ (ce que signifie la proposition $A\mathrm{\, OU\, } B$) et qu'on n'a pas $A$ (ce que signifie la proposition $\mathrm{NON\, } A$) alors on a $B$ ; mais on voit que cela repose sur le fait que la proposition $\mathrm{NON\, } A$ implique qu'on n'a pas $A$, c'est-à-dire sur le principe de non-contradiction qui dit qu'on ne peut pas avoir à la fois $A$ et $\mathrm{NON\, } A$. Ainsi, les règles de déduction de la logique classique ont été formulées en vue d'une logique sans contradictions ; et quand on les applique pour montrer qu'une éventuelle contradiction contaminerait toutes les propositions, on oublie que leur justification intuitive n'est plus valable dans ce cas : on fait tourner un formalisme en ayant oublié sa justification intuitive ! Le fait qu'une contradiction contamine toutes les propositions est donc vrai dans la logique classique, à cause de son syllogisme disjonctif ; mais là où il y a des contradictions la logique classique n'est pas adaptée : le syllogisme disjonctif n'est plus justifié et il n'est pas vrai qu'une contradiction doive contaminer tout le langage. Dans la vraie logique du langage quotidien (où il y a des contradictions, comme celle du Menteur), de $A$ et $\mathrm{NON\, } A$ on peut déduire des propositions comme $A\mathrm{\, OU\, } B$ ou $(\mathrm{NON\, } A)\mathrm{\, OU\, } B$ mais, faute du syllogisme disjonctif, on ne peut pas en extraire $B$ ; la seule façon d'éliminer la disjonction est de revenir aux données $A$ et $\mathrm{NON\, } A$ : ainsi, loin d'être contagieuses, les contradictions sont stériles dans la logique du langage quotidien.
Remarque
(Syllogisme disjonctif et implication)
En logique classique, $(\mathrm{NON\, } A)\mathrm{\, OU\, } B$ coïncide avec $A\implies B$ (c'est la définition du connecteur $\implies$). Dans la logique du langage quotidien, ce n'est plus vrai si on donne à $A\implies B$ son interprétation intuitive (« quand on a $A$ on a $B$ »). En effet, on vient de voir que si on a une contradiction, disons $A$ et $\mathrm{NON\, } A$, alors on a $A$ et on a $(\mathrm{NON\, } A)\mathrm{\, OU\, }B$ mais on ne peut pas en tirer $B$ ; donc $(\mathrm{NON\, } A)\mathrm{\, OU\, }B$ ne signifie pas qu'avec $A$ on a $B$.
Si on se limite à une partie du langage dans laquelle on a de bonnes raisons de penser qu'il n'y a pas de contradictions, on peut y appliquer les règles de la logique classique. Mais d'abord, comment trouver une partie du langage dans laquelle le paradoxe du Menteur ne puisse être formé ? D'où est venu, au fond, ce paradoxe ?
Autoréférence et cercle vicieux.
Si une phrase $A$ dit d'une autre phrase $B$ qu'elle n'est pas vraie, il n'y a pas de contradiction : $A$ est vraie si et seulement si $B$ ne l'est pas. La contradiction surgit quand on prend $B=A$ (« la présente phrase n'est pas vraie ») : alors $A$ est vraie si et seulement si elle ne l'est pas. Le problème vient donc de ce que cette phrase particulière s'applique à elle-même. Je dis cette phrase particulière car en général, quand une phrase se réfère à elle-même, cela ne pose pas de problème logique. Exemples :
La présente phrase est écrite en français.
La présente phrase se termine par un point.
La présente phrase contient six mots.
Ou ce joli pangramme autodescriptif de Gilles Esposito-Farèse4 :
Cette phrase autodescriptive contient exactement dix a, un b, huit c, dix d, trente-trois e, un f, cinq g, six h, vingt-sept i, un j, un k, deux l, deux m, vingt-cinq n, dix o, huit p, six q, treize r, quinze s, trente-deux t, vingt-deux u, six v, un w, quatorze x, un y, quatre z, six traits d'union, une apostrophe, trente virgules, soixante-huit espaces, et un point.
Chacune de ces phrases énonce sur elle-même un fait testable (et vrai). Certes, contrairement à la phrase du Menteur, elles parlent de leur forme et non de leur vérité ; mais considérons alors la phrase :
La présente phrase est vraie ou ne l'est pas.
Elle parle de sa vérité et de rien d'autre, comme la phrase du Menteur, et pourtant elle n'a rien de paradoxal : elle est tout simplement vraie.
L'autoréférence ne produit donc pas que des paradoxes. Mais elle semble quand même jouer un rôle crucial dans la construction du paradoxe du Menteur. En effet, voyons si on peut le modifier de façon à supprimer l'autoréférence tout en maintenant la contradiction. Une tentative bien connue consiste à la remplacer par ce diptyque contradictoire :
La phrase ci-dessous n'est pas vraie.
La phrase ci-dessus est vraie.
Aucune des deux phrases ne se réfère directement à elle-même. Mais chacune se réfère à l'autre et donc indirectement à elle-même : on peut parler d'autoréférence indirecte, ou de cercle vicieux.
Le cercle vicieux peut être plus caché, comme dans cette version de Yablo5 (1993), qui présente une liste infinie de phrases dont chacune affirme que les suivantes sont fausses :
\begin{eqnarray*} S_1&=&\textit{« pour tout $k>1$ la phrase $S_k$ est fausse »}\\ S_2&=&\textit{« pour tout $k>2$ la phrase $S_k$ est fausse »}\\ S_3&=&\textit{« pour tout $k>3$ la phrase $S_k$ est fausse »}\\ \textrm{etc.}&&\\ \end{eqnarray*}
Si $S_n$ est vraie, alors $S_{n+1}$ est fausse et toutes les suivantes aussi, mais ce dernier point signifie que $S_{n+1}$ est vraie et donc $S_n$ est fausse : contradiction ! Cela montre qu'aucune des phrases de la suite ne peut être vraie. Mais si elles sont toutes fausses, chacune est vraie (puisque ses suivantes sont bien fausses) : paradoxe ! Pourtant, là, on pourrait croire qu'il n'y a pas de cercle vicieux (et c'est ce que prétend Yablo) : apparemment aucune des phrases ne parle d'elle-même. Quoique... Chacune parle de celles qui la suivent, donc elle fait allusion à sa propre place dans la suite, et par-là elle parle d'elle-même. D'ailleurs, la suite $(S_n)$ est censée être définie par $$S_n\overset{\textrm{déf}}{=}\textit{« pour tout $k>n$ la phrase $S_k$ est fausse »}$$ mais cette « définition » présuppose l'existence de la suite. Il y a donc bien un cercle vicieux.
Bilan :
on conclut de tout cela que le paradoxe du Menteur et ses semblables dépendent d'une forme ou d'une autre d'autoréférence (ou de cercle vicieux).
Ce qui va nous donner une piste pour les éviter quand ce sera nécessaire, et c'est ce qu'on va voir maintenant.
Le Menteur et la Science.
Les paradoxes comme le Menteur sont des curiosités qu'on peut rencontrer de temps en temps dans le langage quotidien ; ils ne le mettent pas en péril. Il n'en serait pas de même dans une science déductive, basée sur la logique formelle classique, où la moindre contradiction pourrait donc contaminer et invalider tout l'édifice. Il faut que le langage propre à une telle science soit à l'abri de ces paradoxes.
Tarski6 (1931) voit l'origine des paradoxes logiques comme le Menteur dans « la tendance à l'universalisme propre au langage quotidien »7 : ce langage peut parler de tout, y compris de lui-même.
Pour les sciences déductives, Tarski propose d'abord de distinguer différents niveaux de langage. Une science parle d'une certaine catégorie d'objets (l'arithmétique élémentaire parle des nombres entiers ; la géométrie élémentaire parle de points, de droites, de cercles ; la mécanique du point parle de points matériels, de positions, de vitesses, de forces, de trajectoires ; etc.). Pour cela elle utilise un langage qui lui est propre, bien délimité, et qui doit être très précis : Tarski considère des langages formalisés où « le sens de chaque expression est univoquement déterminé par sa forme » ; « le langage et la science constituent un tout organique, à tel point qu'au lieu de parler de tel et tel langage formalisé on parle du langage de telle et telle science formalisée »8.
Pour décrire la grammaire d'un tel langage et parler de ses énoncés (de leur correction grammaticale, de leur sens, de leur valeur de vérité, de la déduction, etc.), il faut recourir à un langage d'un niveau supérieur, un métalangage ; et pour parler du métalangage il faut recourir à un métalangage du métalangage, et ainsi de suite. Le langage quotidien, qui vise à parler de tout, ne fait pas la distinction entre ces différents niveaux de langage ; autrement dit, il les confond et ces confusions conduisent à des paradoxes comme le Menteur. Si $A$ désigne une formule écrite dans un langage $L$, l'énoncé $$F(A)$$ qui dit $$\textit{$A$ n'est pas vraie}$$ est écrit dans un métalangage de $L$, disons $L'$. La distinction des niveaux de langage $L$, $L'$ semble empêcher la formation de la phrase du Menteur. Mais elle n'y suffit pas tout à fait, car on pourrait envisager la possibilité de traduire $F(A)$ d'une manière ou d'une autre dans le langage $L$ lui-même (en conservant sa valeur de vérité). Supposons que ce soit possible et notons $f(A)$ la traduction de $F(A)$ dans $L$ : le paradoxe du Menteur resurgirait s'il existait une formule $A$ pour laquelle $f(A)$ soit logiquement équivalente à $A$ ; car alors on aurait : $A$ est vraie ssi $f(A)$ est vraie, $f(A)$ est vraie ssi $F(A)$ est vraie, $F(A)$ est vraie ssi $A$ n'est pas vraie. Mais puisque ce serait là une contradiction, cela ne peut se produire dans un langage $L$ cohérent (comme l'est, vraisemblablement, le langage de l'arithmétique9) ; et le paradoxe du Menteur devient ainsi une preuve par l'absurde de cette impossibilité. Il permet même de prouver une chose plus profonde : c'est que (sous certaines conditions générales, satisfaites notamment par le langage de l'arithmétique $-$ s'il est cohérent) la fonction $F$ ne peut pas être définie dans le langage $L$ ; autrement dit $f$ n'existe pas (une formulation précise de ce fait donne lieu au théorème de Tarski sur la vérité10, 1933).
Slogan :
un paradoxe dans un cadre mal formalisé devient une preuve par l'absurde de quelque chose dans un cadre bien formalisé.
Brève histoire du Menteur
On voit souvent l'origine du paradoxe du Menteur dans un poème d'Épiménide (siècle $-6$)11, où il fait dire à Minos : « Crétois, toujours menteurs », parce qu'on prétendait en Crète que Zeus était mort et qu'on lui avait même érigé une tombe. Minos étant Crétois, si son accusation est vraie il est lui-même toujours menteur, donc son accusation est mensongère ; si on considère qu'un mensonge est une fausseté12, alors ayant supposé son accusation vraie on la trouve fausse : on peut voir là une simple preuve par l'absurde qu'elle ne peut pas être vraie. Mais si on la suppose fausse, il y a au moins un Crétois qui au moins une fois ne ment pas ; ce qui n'empêche pas l'accusation de Minos d'être fausse, et là il n'y a pas de contradiction. La conclusion est que l'accusation de Minos, prise au pied de la lettre, est fausse. Rien d'étonnant à cela : c'est une hyperbole.
$-$ Diogène Laërce13 (3e siècle) mentionne l'argument du Menteur parmi plusieurs questions de dialectique posées par Euboulide de Milet (siècle $-4$). Là, visiblement, il s'agit bien d'un paradoxe logique étudié en tant que tel (ce qui n'était certainement pas le propos d'Épiménide dans son poème). Mais comme Diogène n'en explicite pas l'énoncé, on ne sait pas sous quelle forme Euboulide l'avait formulé.
$-$ Aristote, contemporain d'Euboulide, mentionne dans le chap. 25 de ses Réfutations des sophistes14 le cas où l'on dit que « le même homme ment et dit la vérité en même temps » ; et il répond que l'homme peut mentir en ce sens qu'il ne dit pas absolument la vérité, tout en disant la vérité en un certain sens ou sur un certain point. Dans un commentaire aux Réfutations des sophistes, dont on possède plusieurs copies médiévales, certaines l'attribuant à Alexandre d'Aphrodise (2e siècle), d'autres à Michel d'Éphèse (12e siècle), d'autres encore proposant Michel Psellos (11e siècle) ou Michel d'Éphèse, on lit15à propos de ce passage : « Cependant, celui qui dit ``je dis faux'' dit en même temps faux et vrai ; il est donc faux [de prétendre] qu'il n'est pas possible que le même [individu] dise en même temps vrai et faux ».
Entre Aristote et Alexandre d'Aphrodise, Cicéron (siècle $-1$), dans ses Premières académiques, II-29, demande si la proposition suivante est vraie ou fausse16 : « Si tu dis que tu mens, et qu'en cela tu dis vrai, tu mens et tu dis vrai. »
$-$ Selon Diogène Laërce17, Chrysippe (siècle $-3$) a écrit plusieurs ouvrages sur le Menteur, dont certains titres donnent une idée des solutions qui avaient été proposées à l'époque. Citons-en trois :
- Contre ceux qui considèrent qu'il existe des [propositions] à la fois fausses et vraies (un livre).
- Contre ceux qui résolvent l'argument du Menteur par division, à Aristocréon (deux livres).
- Contre ceux qui prétendent que l'argument du Menteur a des prémisses fausses (un livre).
Le premier titre concerne ceux qui admettent que la phrase du Menteur est à la fois vraie et fausse. Le deuxième concerne sans doute ceux qui divisent la phrase du Menteur en une proposition vraie et une proposition fausse. Par exemple, le Romain Aulus Gellius (2e siècle) rapporte de Grèce18 cette version : « Quand je mens et que je dis que je mens, est-ce que je mens ou est-ce que je dis la vérité ? » Sous cette forme, le paradoxe n'est pas difficile à dénouer : je formule un mensonge, puis je dis que je mens (en me référant à mon mensonge) ; donc je mens dans la première partie de ma phrase, pas dans la seconde. Le troisième titre de Chrysippe mentionné ci-dessus concerne probablement ceux qui soutiennent qu'une contradiction est une fausseté et qu'on ne peut déduire une fausseté que de prémisses fausses. On va voir tout de suite une « solution » de ce genre (chez Buridan).
$-$ Le paradoxe a fait l'objet de discussions chez les scolastiques. Citons seulement Jean Buridan (14e siècle) qui, dans ses Sophismes énonce le paradoxe comme suit19 :
Le onzième sophisme [...] est « je dis faux », en posant que je ne dis rien d'autre que cette proposition : « je dis faux ».
Buridan propose cette solution :
Je réponds brièvement que le sophisme est faux, puisque de lui et de la proposition exprimant l'hypothèse, s'ensuit quelque chose de faux, alors que l'on pose comme vraie la proposition exprimant l'hypothèse ; ce quelque chose de faux qui s'ensuit, c'est que le sophisme est en même temps vrai et faux. Or une proposition de laquelle suit le faux lorsque quelque chose de vrai lui est ajouté est fausse.
Mais il faudrait expliquer où est l'erreur quand on dit que si la proposition est fausse alors elle est vraie puisque c'est ce qu'elle dit. Buridan écrit :
quand on argumente ainsi : « si elle est fausse, alors il en est ainsi qu'elle signifie », je l'accorde en ce qui concerne sa signification formelle, mais cela n'est pas suffisant en raison de la réflexion sur soi qu'elle comporte. Elle n'est pas vraie, parce qu'il n'en est pas ainsi que signifierait le conséquent qui en découle, avec l'hypothèse qui est faite. En effet, ce conséquent serait que A est vraie, à supposer que cette proposition que je profère soit proprement nommée A, et il n'en est pas ainsi que signifierait la proposition « A est vraie ».
Et pourquoi n'en est-il pas ainsi que signifierait la proposition « A est vraie » ? Parce que Buridan a décrété que A n'est pas vraie ! Et comment comprendre qu'une proposition soit vraie « en ce qui concerne sa signification formelle » tout en n'étant pas vraie en raison de ses conséquences ? Cela n'est guère convaincant. Plus loin, Buridan ajoute (toujours à propos de « je dis faux ») :
si tu veux formuler l'équivalent de ce que je dis, tu diras « tu dis faux et A est vraie » à supposer que ma proposition soit proprement appelée A, et alors la contradictoire serait « tu ne dis pas faux ou A n'est pas vraie », et cette disjonctive est vraie.
Cela revient, en passant par un contradicteur, à diviser la proposition du Menteur en la conjonction de deux opposées « tu dis faux et A [ce que tu dis] est vrai » et à conclure qu'elle est fausse (puisque la négation de FAUX ET VRAI est VRAI OU FAUX, qui est VRAI). C'est dire encore une fois que la phrase du Menteur est fausse parce qu'elle conduit à une contradiction, sans expliquer pourquoi sa fausseté (qui est ce qu'elle affirme) ne permet pas de déduire sa vérité. Le paradoxe n'est toujours pas dénoué.
Signalons qu'on trouve aussi la version en diptyque chez Buridan20 :
Posons par hypothèse que Socrate profère seulement la proposition « Platon dit faux », et que Platon, inversement, profère seulement la proposition « Socrate dit vrai ». On se demande si la proposition proférée par Platon est vraie ou fausse. Et l'on peut aussi s'interroger de cette manière sur la proposition de Socrate.
Bien sûr, Buridan affirme que la proposition de chacun est fausse car « de chacune avec l'hypothèse qui est faite suit quelque chose de faux », à savoir une contradiction. Mais il ne donne toujours pas d'argument convaincant pour empêcher que leur fausseté implique leur vérité.